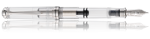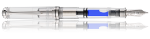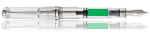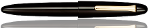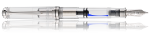https://www.lemonde.fr/m-styles/article ... 97319.html
Voici le texte de l'article pour les non-abonnés :
Caran d’Ache, des mines radieuses
Par Marie Godfrain
Publié le 15 octobre 2022

Dans le canton de Genève, la fabrique familiale de crayons et d’instruments d’écriture a traversé le siècle. Elle continue d’y produire une palette de couleurs d’une richesse exceptionnelle, appréciée des artistes.
Célèbre pour ses manufactures horlogères et ses usines de chocolat, la Suisse a aussi la particularité d’abriter Caran d’Ache, l’une des dernières fabriques de crayons d’Europe. Une rareté pour ces outils habituellement produits en Chine ou en Inde.
« Il y a plus de fabricants de montres de luxe en Suisse que de fabricants de crayons en Europe », résume Eric Vitus, directeur de la section beaux-arts de Caran d’Ache et trente-deux ans d’activité dans cette entreprise emblème du savoir-faire suisse, reconnaissable à ses boîtes en métal rouge ornées d’une croix blanche.
Avec ses teintes subtiles et la qualité incomparable de ses outils de dessin et d’écriture, la marque a conquis les plus grands artistes – Picasso, Miró, Sempé… – et conserve une cote intacte dans les écoles d’art.
Née en 1915 dans le quartier des Eaux-Vives, à Genève, sous le nom de Fabrique genevoise de crayons, la manufacture est rachetée et rebaptisée en 1924 du nom du caricaturiste français Caran d’Ache – à l’origine ce pseudonyme vient du mot karandach, qui veut dire crayon en russe. Puis elle déménage, au début des années 1970, à Thônex, dans les faubourgs de la ville, où elle se trouve encore aujourd’hui. Le rond-point qui y mène est hérissé d’immenses crayons, comme des mâts colorés.
Chiffres secrets et vieilles recettes
Restée dans son jus, l’usine, avec sa façade rideau en tôle ondulée, son architecture moderniste à base de béton et de larges baies, donne sur les montagnes environnantes jusqu’au mont Blanc. Un site de 5 000 mètres carrés ultra-fonctionnel où le bâtiment de l’administration, haut de cinq étages, jouxte celui de la production, divisé en deux espaces : l’un consacré à la couleur et l’autre aux instruments d’écriture.
Discrète sur les chiffres – une spécialité nationale en Suisse –, la direction se refuse à indiquer la quantité de crayons de couleur, feutres, tubes de peinture, pastels, stylos bille, stylos roller et autres porte-mines qui sortent d’ici. Elle préfère insister sur la richesse de sa palette. « Plus de 300 teintes composent notre collection, mais, plus significatif encore, nos plus grandes boîtes de crayons sont composées de 120 couleurs », s’enorgueillit Carole Hubscher, représentante de la quatrième génération, à la tête de la marque familiale.
Ouverte au public, la manufacture ne se visite néanmoins qu’en (petits) groupes, constitués d’étudiants ou d’artistes, le plus souvent. Pour des raisons de sécurité, d’abord, tant les machines sont tranchantes, puissantes. Mais aussi de confidentialité, car la concurrence est féroce et avide de s’approprier les savoir-faire de cette institution dont les outils ont presque tous été développés et fabriqués sur place, explique Eric Vitus.
Une harmonie de verts court sur la plupart des murs de l’usine. « Le propriétaire adorait ces teintes, moins salissantes que le blanc ou le métal brut », commente notre guide, manifestement peu convaincu par ce choix esthétique. En poussant la porte de l’espace crayons de couleur et tout au long de la visite, Eric Vitus file la métaphore de la cuisine. En guise de « mise en bouche », il invite à consulter un livre de « recettes » datant de 1924, trouvé par hasard dans les archives, dans lequel sont rédigés à la main les secrets de composition et de fabrication des crayons.
Un long temps de nettoyage
Il est vrai que tout ici convoque l’art culinaire, gestes, matières premières, accessoires. Dans l’espace carrelé de blanc, un ouvrier prélève de la poudre avec une pelle à farine avant de la peser sur une balance, puis de la mélanger à d’autres ingrédients dans un pétrin de boulanger. A ses pieds sont empilés de gros sacs en kraft de talc semblable à de la farine et, sur les étagères, une collection de saladiers, de casseroles, de contenants… « Pour fabriquer des crayons, il faut de bons ingrédients, une bonne recette et un bon cuisinier », poursuit Eric Vitus.
Ici, on mélange d’abord les pigments, les charges minérales et les liants, qui vont donner leur cohésion aux mines de couleur. Puis on malaxe, broie, extrude la pâte pour la transformer en spaghettis qui deviendront les mines des crayons. La même technique est employée pour les craies à la cire tandis que les pastels à l’huile, eux, sont moulés comme du rouge à lèvres. Il faut ensuite respecter un temps de séchage pouvant atteindre six semaines pour les modèles Luminance, détaille le chimiste.
Les 280 personnes à l’œuvre sur ce site consacrent la moitié de leur temps à nettoyer les machines, « comme on le ferait après avoir cuisiné de la crème au chocolat », afin que les couleurs ne se mélangent pas, puisque, sur une même machine, Caran d’Ache produit l’ensemble de ses teintes.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le stylo 4-couleurs de Bic, nouvelle folie des cours de récré
Une fois les mines réalisées et séchées, direction l’atelier menuiserie. Tous les crayons sont fabriqués en cèdre de Californie, les essais réalisés avec des essences locales se révélant moins fructueux. « Le cèdre est un bois régulier et tendre qui convient parfaitement lors du découpage des crayons et surtout lors du taillage. Il produit alors des copeaux réguliers et continus. Pour le moment, nous n’avons pas rencontré de difficultés concernant une possible augmentation du prix du bois ou l’approvisionnement », rassure Carole Hubscher.
Le bois, sous forme de baguettes, passe sur une ligne de découpage équipée de deux rainureuses qui viennent creuser l’espace dans lequel la mine sera disposée. Lorsque les deux parties du crayon sont refermées, collées et passées sous une presse, l’ensemble est trempé dans un vernis, puis, une fois sec, stocké dans des boîtes en bois avant d’être emballé manuellement par l’une des employées du département dédié. De l’arrivée des matières premières au contrôle qualité, trente-cinq étapes sont nécessaires pour réaliser un crayon.
Déménagement en vue
De l’autre côté de l’austère corridor, la partie instruments d’écriture – près de la moitié de la production et du chiffre d’affaires de Caran d’Ache – est un immense espace scindé en ateliers protégés par des cloisons vitrées d’une grande efficacité. Si certains métiers sont très bruyants, comme le façonnage des tubes de métal des stylos bille, l’équipe du service qualité travaille, elle, dans un silence de cathédrale nécessaire à la concentration.
Le laboratoire, antichambre de tout ce qui se produit ici, se situe dans les étages du bâtiment administratif et nous replonge sans transition dans les années 1970 : fenêtres rectangulaires panoramiques, linoléum au sol, étagères en mélaminé, stores vénitiens, fleurs séchées dans un vase. « Ces hortensias ne sont pas là pour la déco, mais pour nourrir l’inspiration, tient à préciser Eric Vitus. Leurs teintes passées ont servi à élaborer un vieux rose et un violet crémeux entrés en collection récemment. »
Un développement plutôt rare, puisque, aujourd’hui, Caran d’Ache travaille davantage à reformuler la composition de ses crayons et pastels plutôt qu’à développer de nouvelles couleurs, explique le chimiste, qui passe ses derniers mois dans ce siège historique. Voilà quelques années, en effet, qu’un projet de déménagement de Caran d’Ache est mis sur les rails par sa présidente, qui en expose la maquette dans le restaurant d’entreprise du rez-de-jardin où elle vient échanger entre la poire et le fromage avec les salariés.
Dessiné par l’architecte suisse Pierre-Alain Dupraz, le nouveau bâtiment sera « plus proche de l’autoroute, autonome, doté de panneaux solaires, beaucoup plus ergonomique et confortable que le siège actuel, qui sera rasé et remplacé par un ensemble d’immeubles d’habitation », assure sa dirigeante. Plus performant, sans doute, mais indéniablement dénué du charme qui fait de cette bâtisse des années 1970, avec son logo vintage accroché en haut de la façade, l’un des témoins de l’industrie des « trente glorieuses ».