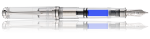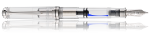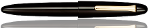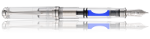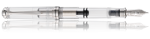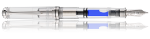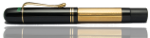En 1870, un Jean-Frédérick Pelletier, meurtri par la guerre, quitte Chassors et l'Angoulêmois pour s'installer à Bruxelles comme marchand de papier. Au numéro 56 du quai aux Pierres de taille, il plante sa fabrique dans un extraordinaire embrouillamini de petites bâtisses imbriquées les unes dans les autres pour former un énorme îlot rectangulaire parsemé d'impasses. Ce quartier est un des plus animés de Bruxelles, dont les noms évoquent sa tradition portuaire : quai des Péniches, Impasses des Bateliers ou du Navire.
Au début des années 1870, lorsque l'établissement Pelletier ouvre ses portes, la situation de l'industrie papetière en Belgique est au beau fixe. Ce sont surtout les papiers de qualité pour l'écriture qui font la réputation du Brabant hors des frontières. C'est justement la spécialité que notre jeune industriel va développer.
En 1876, après trente mois de travaux et l'expropriation du centre de l'îlot, l'école communale de la rue du Canal est inaugurée en grande pompe. Mais déjà Frédérick Pelletier a quitté sa fabrique, pour déménager à Saint-Josse où le fondateur meurt subitement en 1884, à l'âge de 43 ans.
MÉTAMORPHOSE D'UN QUARTIER
Sa jeune veuve, de petite noblesse allemande, s'appelle Marie-Amélie von Stahl et n'a d'autre issue que de reprendre l'affaire. Ce qu'elle fera jusqu'à son dernier souffle.
Et de quelle manière ! En 1889, la voilà qui déménage l'usine au boulevard Bisschofsheim, un œil rivé sur son concurrent Nias, déjà installé rue Neuve. Elle développe le commerce de gros, les cartonnages et les enveloppes, puis achète, en 1897, 20 ares de terrain rue de Linthout.
En deux ans, elle y construit une usine modèle : un couloir en verrière traverse les jardins qui séparent l'usine de la rue. Les façades en briques émaillées blanches sont entourées de verdure et à l'intérieur, ce sont 3.500 m² dont 2.500 d'ateliers qui vibrent comme une ruche. La spécialité reste le papier de luxe. La fabrique Pelletier possède un atelier spécialisé dans les bordures, une fabrique de cartonnages et de papiers d'emballage, sans oublier la dorure au balancier. Mais ce qui fait la renommée et bientôt la réussite de la maison, ce sont les papiers anglais, à la marque «Original Crown Mill» (littéralement : moulin -à papier- royal). Un papier vergé, crémé, destiné aux personnes dont l'écriture goûte la finesse d'un papier voluptueux. De son magnifique hôtel de maître, à deux pas de l'usine, la veuve Pelletier gouverne et investit dans l'immobilier.
En 1900, elle reçoit l'autorisation de percer une artère perpendiculaire à la rue de Linthout. Elle portera dès sa création le nom de Frédérick Pelletier, bienfaiteur du quartier via sa veuve.
De 1900 à 1912, les terrains entourant la fabrique sont progressivement bâtis. Les douze maisons de rentiers à droite de l'usine, en briques blanches et appareillées de pierre bleue, sont toutes semblables sauf, à bien y regarder, dans le détail des impostes par exemple. La firme construit encore, à l'angle de la nouvelle rue, un imposant immeuble avec loggias et colonnades, magasins au rez-de-chaussée et grands appartements aux étages. Juste avant la première guerre mondiale, toute la physionomie du quartier a changé. Son dynamisme aussi ! Logements, commerces et emplois : que demander de plus ?
D'UNE VEUVE À L'AUTRE
Mission accomplie, Marie-Amélie von Stahl-Pelletier laisse l'affaire à ses fils, Léon et Maurice, pour se remarier à l'âge de 72 ans. Les frères constituent, le 1er janvier 1913, une société en nom collectif qui garde le prénom de leur père. L'un habite d'ailleurs dans la rue qui porte son nom, et l'autre derrière le coin, rue de Linthout. Ensemble, ils hisseront la papeterie Pelletier dans le top des leaders mondiaux du papier de luxe. Dans l'entre-deux-guerres, Léon et Maurice Pelletier diversifient la production et exportent, en Europe et vers l'Afrique. Fournitures de bureau mais aussi matériel scolaire pour les missions : cahiers, colles et encres de toutes sortes. D'où l'encrier, objet publicitaire amusant que la firme ne se fait pas faute d'exploiter.
Les fils du fondateur sont aussi des hommes de contact. Ils se posent en locomotives de la vie culturelle et économique de la capitale. Quant à l'épouse de Maurice, Louise Donies, issue d'une ancienne famille patriarcale, elle est peintre et poète. Amie de Maurice Carême, elle ouvre un salon littéraire dans une partie réservée de l'hôtel familial, 63 rue de Linthout. Louise Donies participe aussi à la vie de la fabrique, ce qui s'inscrit dans une logique paternaliste typique de l'époque. Elle est sensible aux conditions de travail, particulièrement celles des femmes, majoritaires dans l'usine. Les hommes travaillent aux machines, les dames et demoiselles à l'emballage. C'est aussi Louise qui, de sa plume d'artiste, a gravé la signature qui orne les belles boîtes d'enveloppes et de papier Pelletier.
Du mariage de Maurice Pelletier avec Louise Donies naîtront Anne-Marie et Frédéric. Ce dernier a vingt ans quand survient la seconde guerre mondiale. Son père meurt en pleine guerre alors qu'il se démène pour sauver ses ouvriers du STO (service du travail obligatoire en Allemagne) et ses machines des réquisitions.
La veuve reprendra-t-elle les rênes ? Mais oui, avec Léon, son beau-frère, et son fils, jeune ingénieur chimiste qui va développer les laboratoires de l'usine.
LA FAILLITE D'UN SYSTÈME
Anne-Marie, la fille de Maurice Pelletier, a épousé le directeur commercial de l'usine qui, lui, parcourt le monde pour la firme et crée à Kinshasa l'antenne «Pelletier Zaïre». Combien d'écoliers ont eu dans leurs cartables ces cahiers aux couleurs tendres, signés Pelletier ? Pourtant, les profits ne suffisent plus à faire vivre la fabrique de la rue de Linthout. Dès les années soixante, il aurait fallu rationaliser, et surtout licencier durant la décennie suivante. Impossible pour ces patrons, dont les ouvriers ont vécu toute leur vie à leurs côtés, certains même sur plusieurs générations.
La faillite est prononcée en 1985. La curatelle ne juge pas possible de sauver l'hôtel de maître. L'usine est démolie, même si la façade est sauvegardée. A son emplacement se trouvent aujourd'hui les rédactions de l'agence Belga et du quotidien «Le Matin».
DU PAPIER DE LUXE VENDU AU JAPON
En juin 1985, lors de la faillite Pelletier, un homme se dit qu'il est impossible de laisser partir une telle affaire. Bernard de Frahan ne peut cependant racheter les bâtiments mis sous curatelle. Il décide de s'installer provisoirement rue de Gosselies à Molenbeek. Quinze ans plus tard, l'usine est toujours là, même si son directeur ne désespère pas de déménager un jour.
Ce qui l'intéresse surtout dans le rachat, c'est l'Original Crown Mill. Il va décupler sa production, passant de 30 à 300 tonnes par an. Il faut dire qu'il diversifie le produit, crée sept couleurs de papier et fabrique les enveloppes à doublure assortie. Avec son partenaire français Jean Rouget, actionnaire à 25 %, Pelletier se repositionne sur la France avant d'exporter en Italie, en Grande-Bretagne et jusqu'au Japon, pays friands en papiers de luxe.
Réginald, son fils, a dans la foulée créé la société «First Cards». Ses albums de cartons et faire-part sont sur les comptoirs de toutes les grandes papeteries de Belgique et d'Europe. Les cartes de fin d'année par exemple, gravées par des artistes, et nécessitant plusieurs passages en machines, lui ont ouvert récemment le marché new-yorkais.’’Source : BRUXELLES, MA BELLE INDUSTRIELLE (I) LAUSBERG, SYLVIE Page 7 Vendredi 14 juillet 2000
Extrait de "Mille & une plumes belges" pp. 154 et 155
Long préambule pour présenter ce joli vintage BCHR "IMPERIAM PELLETIER" de la firme.




Robert